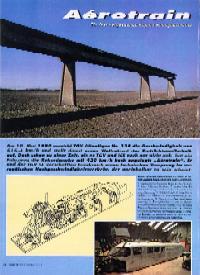




|
Aérotrain
Un chapitre presque oublié de l'histoire du rail
Le 18 mai 1990, le T.G.V. Atlantique N°325 atteint la vitesse de 515,3 km/h et établit ainsi un record de vitesse sur rail. Pourtant, il y
a bien longtemps, alors que le T.G.V. et ICE n'existaient pas encore, un véhicule, l'Aérotrain, avait avec une vitesse de 420 km/h,
placé la barre du record très haut. Celui-ci et le T.G.V. Sud-Est donnèrent à la France, dans le domaine européen des transports à haute
vitesse, une avance technologique qui semble difficile à rattraper.
Aérotrain
C'était il y a plus de vingt ans : la France disposait encore de quelques lignes maritimes luxueuses et prestigieuses, l'énergie nucléaire
naissait et le Concorde volait pour la première fois. A cette époque - où la technique semblait sans frontière et sans limite - l'Aérotrain
Expérimental 02 atteignit une vitesse de 418 km/h. Les responsables jubilèrent : on allait pouvoir relier Paris et Lyon en à peine plus
d'une heure.
Vingt ans plus tard, l'enthousiasme s'est envolé : le développement du système prévu pour relier les villes à 350 km/h a été arrêté peu
d'années après la fin des essais. Derrière une maison pleine de tags, qui à l'époque était une maison de garde-barrière de la compagnie
nationale des chemins de fer, se dessinent dans le brouillard dense les contours d'une grosse construction, un hangar.
Le vent, qui passe à travers les nombreux trous des parois en tôles, produit un sifflement strident. Rien d'autre sinon ne brise le silence
de cet endroit abandonné. Les grosses poutres d'un pont roulant sortent des deux côtés du hangar. Elles dominent une sorte de rail de béton
qui se perd dans une haie de broussailles. Les portes massives du hangar sont fermées. A travers une petite ouverture, la lumière de nos
lampes-torche pénètre à l'intérieur du hangar, se perd dans la pénombre jusqu'à ce qu'elle rencontre une chose énorme, massive, longue,
rouillée, aux vitres cassées avec, peints à l'arrière, un gros "A" posé sur un "T" inversé : l'emblème de l'Aérotrain. Dans un hangar voisin,
nous trouvons deux autres engins qui portent l'inscription "Aérotrain Expérimental".
A Chevilly, au nord d'Orléans, nous découvrons finalement le plus gros engin que la Société de l'Aérotrain ait construit. Il sert
aujourd'hui de terrain d'aventure pour les jeunes, de nombreux sièges sont déchirés, la cabine de pilotage est complètement détruite.
C'est donc dans cet état que se trouvent les restes tragiques du projet de haute vitesse des années 70 - oubliés et livrés à la dégradation.
La technique de l'Aérotrain
L'Aérotrain n'est, au sens propre, ni un train ni un avion, mais plutôt un engin à coussins d'air guidé par un rail. Le contact avec le rail
n'a lieu qu'à l'arrêt, pas pendant la marche. Ainsi le fonctionnement n'engendre ni frottement, ni vibration désagréable. Alors qu'un
coussin d'air produit l'essor de l'engin, une hélice en assure la propulsion. L'avantage des engins guidés sur coussins d'air réside dans
le fait qu'ils peuvent par exemple s'arrêter à des quais de gares. Ceci est impossible pour les véhicules libres (par exemple les
Hovercrafts qui traversent la Manche).
L'histoire de l'Aérotrain
Jean Bertin, le pionnier français de la technique du coussin d'air, s'intéressa d'abord aux engins à coussin d'air non guidés et développa
dans les années 50 un "Aéro-Planeur" qui (avec quelques places) pouvait voler à une faible hauteur au dessus de l'eau. Comme le coussin
d'air ne peut compenser les irrégularités du terrain que grâce à de grandes jupes, sa mise en oeuvre sur terre n'était possible que sur un
tracé spécial. Pour minimiser la place nécessaire, Bertin choisit donc un rail qui devait garder l'engin sur un chemin défini.
Le concept intéressa le Ministère français de la Recherche, si bien qu'en peu de temps, les plans et la phase d'étude purent être menés à
bien. En 1963, la Société de l'Aérotrain présenta pour la première fois une maquette de son train au public. Au même moment commençait la
construction de l'Aérotrain Expérimental 01 de 6 places, à l'échelle 1/2 des modèles de série prévus qui devaient comporter de 50 à 100
places.
L'Aérotrain Expérimental 01 circulait sur une voie d'essais de 6,7 km de long située près de Gometz la Ville dans le département de
l'Essonne. C'est sur cette voie qu'eut lieu le premier essai, le 29 décembre 1965. L'Aérotrain Expérimental 01 atteignit alors la vitesse
de 90 km/h. Presque un an plus tard, la Société de l'Aérotrain commença sa première expérience sur les hautes vitesses : l'Aérotrain
Expérimental 01 fut équipé d'une fusée d'appoint et circula à la vitesse de 303 km/h. En 1967, on remplaça l'hélice de propulsion par une
turbine à gaz de type Turboméca Marboré de 4,7 kN de poussée. Avec deux fusées d'appoint, on put atteindre la vitesse de 345 km/h, vitesse
à laquelle l'Aérotrain Expérimental 01 avait trouvé sa limite.
Aérotrain Expérimental 02
La deuxième machine ressemblait un peu à un avion bombardier de la deuxième guerre mondiale dont on aurait amputé les ailes. Par rapport à
son prédécesseur, l'Aérotrain Expérimental 02 ne possédait pas une cabine de passagers mais son cockpit était doté de deux sièges.
La propulsion était assurée par un réacteur Pratt & Whitney JT12 de 12,3 kN de poussée qui avait été construit pour les avion civils. Avec
une turbine de cette capacité, l'Aérotrain Expérimental 02 convenait tout à fait à la recherche sur les hautes vitesses.
En 1969, l'Aérotrain Expérimental 02 établit, avec une vitesse de 418 km/h, le record du monde pour véhicules guidés sur rail, et seule la
faible longueur de la voie d'essais interdit une vitesse encore plus élevée.
En 1969 également, l'Aérotrain Expérimental 01, avec 3000 voyages et 18600 kilomètres, avait transporté en utilisation régulière 5500
passagers et parmi eux de nombreux Chefs d'Etat étrangers.
Aérotrain
En 1969 arriva le stade où l'Aérotrain Expérimental 01, avec sa petite taille, ne fut plus suffisant. La Société de l'Aérotrain voulut
disposer d'un engin en vraie grandeur susceptible de donner une meilleure idée du procédé au point de vue économique. L'engin, issu de
la collaboration entre SECA et UTA ressemblait, avec son revêtement en aluminium lisse, à un obus. Il était long de 27 mètres, large
de 3,2 et comportait 80 places. L'arrière de l'obus était surmonté d'une hélice carénée qui fut remplacée, en 1973, par un réacteur de
Jumbo Jet Pratt & Whitney JT8D-7, ce qui permit d'atteindre une vitesse de croisière de 290 km/h. Pour cet engin, qui fut baptisé
"Orléans 250-80", la voie d'essais de 6,7 km de long près de Gometz la Ville ne suffisait plus. C'est pourquoi on construisit au nord
d'Orléans une voie d'essais de 18 km sur laquelle, l'Orléans 250-80 avec 225 kN de poussée "dans le dos" atteignit la vitesse de 422 km/h.
Pendant deux ans encore, l'Aérotrain poursuivit ses essais avant que son exploitation ne s'arrête. La Société commença encore à travailler
sur l'engin suburbain S44, qui devait assurer une liaison entre l'intérieur des villes et les aéroports à la vitesse de 200 km/h. Le
coussin d'air du S44 n'était plus - comme pour les autres modèles - créé par une turbine à gaz, mais par des ventilateurs électriques. La
propulsion était assurée par un moteur électromagnétique ("moteur linéaire"). Avec cette innovation, le S44 était bien plus silencieux que
les autres modèles équipés de turbines d'avions bruyantes.
A l'étranger, le développement de l'Aérotrain était suivi avec attention. Une entreprise suédoise et les USA furent très intéressés par
l'achat des brevets Bertin. En 1971, le constructeur reçut la plus haute distinction de l'Académie Française des Sciences, le prix du
Crédit Lyonnais. Mais cette reconnaissance ne permit pourtant pas au projet d'aboutir.
Problèmes financiers
Le financement d'un projet sur la base de l'épargne entraîne à long terme de gros problèmes. Pendant toutes ces années, la Société de
l'Aérotrain avait investi dans le projet presque 30 millions de francs sur ses propres finances. D'autres partenaires financiers ne furent
pas trouvés. Le risque leur paraissait trop grand car au début des années 70, on comptait déjà de multiples projets de lignes d'Aérotrains
dont l'Etat s'était retiré à la dernière minute pour des raisons futiles. De nombreuses communes se dressaient également contre le train
qui devait traverser bruyamment leur territoire, mais sans s'y arrêter.
Dissensions au sein de la Commission
L'Etat français délégua la surveillance du projet Aérotrain à la "Commission Aérotrain". Les membres de la Commission, entre autres la
SNCF et la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) avaient leur propre projet de train à grande vitesse, qu'ils ne voulaient pas
sacrifier au profit de l'Aérotrain. Ainsi, l'Aérotrain se trouvait depuis le départ sous une mauvaise étoile. Il en va de même pour le
Transrapid magnétique allemand : ses concurrents, la Lufthansa et la société des chemins de fer allemands qui siègent à sa Commission,
ont ralenti le projet avec tant de succès que la technique magnétique japonaise a rattrapé entre-temps la décennie d'avance allemande.
La fin de l'Aérotrain
En 1970, la Société de l'Aérotrain se porta candidate à la réalisation d'une liaison à grande vitesse entre Paris et Lyon, mais reçut
pourtant comme réponse que l'Aérotrain, avec sa vitesse de croisière de 250 km/h était trop lent. Là-dessus, Jean Bertin et ses techniciens
retournèrent à nouveau dans leurs laboratoires et présentèrent après plusieurs années un projet d'Aérotrain circulant à 400 km/h.
Les discussions se prolongèrent ; la polémique s'accrût ; l'Aérotrain était trop bruyant. Les mesures montraient pourtant que le "Capitole",
un train rapide Paris-Toulouse, émettait une puissance de bruit de 90 dB(A) à 170 km/h contre 92 pour l'Aérotrain circulant à 350 km/h.
Mais la SNCF était d'avis que le bruit du chemin de fer, acquis, n'avait plus à être justifié.
Finalement, les adversaires de l'Aérotrain rechignèrent en invoquant l'aspect inesthétique du rail des engins sur coussins d'air.
L'Aérotrain glisse sur un rail de béton disposé à environ 5 mètres du sol, tandis que le T.G.V. circule entre de hauts murs et de hautes
grilles.
Les défenseurs de l'Aérotrain mettaient en avant la grande sécurité du système : pour le monorail, tout déraillement est pratiquement
impossible, la voie est d'un entretien très facile et le confort est énorme puisque les coussins d'air n'entraînent ni choc ni vibration.
L'Aérotrain peut s'adapter au mieux à la topographie des lieux traversés et nécessite moins de tunnels et de ponts. Les frais fixes étant
moindres, cela compense les frais de fonctionnement plus élevés et ainsi les comptes de l'Aérotrain peuvent être équilibrés. Pourtant, en
1975 fut annoncé officiellement que la nouvelle liaison rapide Paris-Lyon serait assurée par la technique classique roue/rail et qu'un
train à grande vitesse, le T.G.V., relierait Paris-Gare de Lyon et Lyon-Perrache. Que le T.G.V. Sud-Est circule finalement à une vitesse
légèrement supérieure à 250 km/h est une farce de l'histoire du rail...
Nouvelle technique sans avenir ?
Le vieux duel entre le monorail et la technique classique roue/rail est entré à la fin des années 80 dans une nouvelle phase : pendant que
le Transrapid 06 II allemand, doté d'une sustentation magnétique et d'un moteur linéaire pour sa propulsion, atteignait en 1990 une
vitesse de 486 km/h, le T.G.V. Atlantique, le 18 mai 1990 remportait une victoire provisoire à 515,3 km/h.
Mais la course n'est pas encore jouée et il reste à espérer que le meilleur système l'emportera chez ceux qui ont la décision politique à
prendre. Un jour peut-être, on se souviendra du pionnier du monorail Jean Bertin et de son Aérotrain, et on restaurera un des hangars
poussiéreux pour en faire un musée racontant l'histoire d'une variante du rail, l'Aérotrain, un train rapide qui a fini dans une impasse
politique.
Xavier DEBREUILLE, Siegfried ELGERT, inse
(Traduction : Pierre BOUILLET - Décembre 1993)
© EISENBAHN KURIER - Juillet 1991
|
|